Coutumes et usages culinaires de
la fleur de chanvre
au Moyen-Orient
Pendant l'âge d'or de l'Islam (VIIIᵉ - XIIIᵉ siècles), la fleur de chanvre se diffuse de la Perse aux différents sultanats et devient un élément controversé de la culture arabe. Des poèmes persans aux pratiques mystiques soufies en passant par les plaisirs raffinés des cours orientales, on retrouve pourtant la plante dans tout le pourtour méditerranéen.
Cette tradition, à la fois spirituelle et sensorielle, traversa les siècles et influença, bien plus tard, la perception occidentale de la fleur de chanvre, qui s’en inspira au XIXᵉ siècle à travers l’orientalisme, la littérature décadente et les cercles artistiques fascinés par l’imaginaire des paradis artificiels.

Écrit par
Julien Milliard

De plante médicinale au rituel sacré
Même si son introduction au Moyen-Orient remonte aux Iᵉ - IIIᵉ millénaire avant notre ère, la présence du chanvre s'est pendant longtemps limitée à l'usage de la fibre et de ses grains. C’est à partir de l’époque des Abbassides (VIIIᵉ-XIIIᵉ siècle) que la consommation de chanvre sous forme de résine (ḥashīsh) devient monnaie courant dans le monde arabo-musulman. Héritée des traditions persanes et indiennes, cette plante s’est rapidement imposée comme un élément incontournable, aussi bien pour ses vertus médicinales que pour ses usages spirituels et récréatifs.
Les savants persans, tels qu’ Avicenne (Ibn Sīnā) et Al-Rāzī, la mentionnent déjà dans leurs traités médicaux. Avicenne (980-1037), dans son Canon de la médecine, évoque le chanvre comme remède contre les douleurs, les nausées et certains troubles nerveux, tout en avertissant sur les excès qui « troublent l’esprit ». Al-Rāzī (865-925), quant à lui, l’intègre dans ses écrits pharmaceutiques comme plante à la fois curative et contemplative. Ces textes témoignent d’une approche équilibrée, où la nature, considérée comme un don divin, offrait ses vertus à condition de les employer avec mesure et sagesse.
L’influence du cannabis s’étendit également à la culture poétique et mystique. Les grands poètes persans tels que Jalāl al-Dīn Rūmī (XIIIᵉ siècle) et Hafez de Shiraz (XIVᵉ siècle) évoquèrent à travers des images d’ivresse et de vertige les états de conscience altérés que recherchaient les mystiques.
Ces poèmes, bien que voilés sous le langage de l’amour et du vin, font écho aux pratiques spirituelles où les plantes et les substances naturelles étaient perçues comme des moyens d’ouverture à l’invisible.
Plus tard, c'est notamment dans les confréries soufies (Tariqa) que la fleur prendra une place importante. Certains derviches, cherchant à atteindre l’extase spirituelle (fanāʾ), utilisaient le cannabis sous forme de boisson ou de pâte sucrée, estimant qu’il aidait à « dissoudre le moi » pour mieux percevoir la présence divine. Cette consommation, loin d’être profane, s’inscrivait dans une quête d’union avec Dieu à travers l’oubli du corps et des limites du monde matériel. Des chroniqueurs arabes médiévaux relatent que ces cérémonies mêlaient chants, danses, encens et parfois des préparations à base de ḥashīsh, consommées dans un cadre collectif et sacralisé.
La fleur dans la cuisine arabe
Consommé sous forme d’élixirs, de confiseries et de préparations sucrées comme le maʿjūn, la fleur de chanvre n’est pas seulement un produit récréatif, mais un vecteur d’introspection et de contemplation spirituelle.
Dans un rapport du docteur R. J. Bouquet pour les Nations Unis de 1950, sont décrites les différentes préparations culinaires et autres boissons les plus courantes retrouvées à l'époque dans les différentes localités arabes. Même si peu d'informations sont disponibles sur ces préparations du fait de leur transmission orale, le travail du docteur Bouquet a mis en lumière la richesse et l'inventivité de la cuisine arabe dans l'utilisation de la fleur mais aussi les ressemblances entre les différentes régions.
Ces préparations n'ont jamais fait l'objet d'un traffic ou d'un commerce à proprement parler. Elles étaient confectionnées artisanalement, au gré des envies des consommateurs locaux, selon des usages profondément ancrés dans la vie quotidienne régionale. Dans la plupart des recettes, le hashish était la substance préférée pour leur réalisation.
La recette du Majoun
Si la recette du Hashish Fudge de Brion Gysin qu'empruntera Alice B Toklas est à la base inspirée de la fameuse patisserie marocaine surnommée "potion d'amour", elle n'a pas grand chose à voir avec l'originale. Nous vous proposons une recette de Majoun avec de la fleur d'oranger et nappé de chocolat noir.
Les boissons : macérations rituelles et elixirs parfumés
Les préparations destinées à une consommation liquide se divisent historiquement en deux grandes familles. Le type Assis consiste en une macération de feuilles ou de sommités de chanvre dans de l’eau froide ou tiède. La résine n’étant pas soluble dans l’eau, ces breuvages demandaient une proportion importante de plante, souvent broyée au mortier jusqu’à obtenir une pâte fluide avalée en entier.
À l’opposé, le type Esrar reposait sur des macérations alcooliques : la résine se dissolvait alors dans l’alcool, donnant naissance à des élixirs denses et parfumés, souvent mélangés à des sirops aromatiques ou à des confitures diluées dans des eaux florales — rose, jasmin ou fleur d’oranger. Certaines boissons traditionnelles du Proche-Orient, comme le bers (ou berch), le chastig ou le chats-raki à base d’anis, en sont issues. Chacune de ces préparations était le fruit d’un savoir-faire secret, transmis localement. Certains observateurs ont noté au début du XXᵉ siècle que ces boissons faisaient l’objet d’un usage répandu dans d'autres régions du monde comme dans les régions asiatiques de ertaines régions d’Asie, telle que la Sibérie.
Les délices et autres patisseries orientales
Beaucoup plus variées et inventives, les préparations solides ou semi-solides témoignent d’une véritable créativité culinaire. Les artisans y adaptaient les techniques de confiserie pour y incorporer la résine ou la poudre de chanvre, souvent associées à des ingrédients nobles et des parfums réputés pour leurs vertus tonifiantes ou aphrodisiaques.
Au Maghreb, le type Manzul associait environ 10% de résine à de l’huile de sésame, parfois du beurre de cacao, du chocolat, et un assortiment d’épices et de fruits secs — amandes, pistaches, noix, pignons, voire graines de céleri ou de cresson. Pétrie à la main, la pâte était aplatie puis découpée en petits disques destinés à être mâchés lentement. Les Helwa (ou Haloua), confiseries proches du Manzul, se répandirent dans tout le bassin méditerranéen, souvent préparées sans substance active et consommées comme douceurs ordinaires. Le Majoun était, quant à lui, un mélange de miel, de résine, de gomme arabique et d’épices, roulé en pastilles à avaler, parfois réservé à des usages festifs ou médicinaux.
Il existait d’ailleurs autant de variantes que de régions : lorsqu’on évoquait un « majoun égyptien », il aurait été plus juste de parler d’un « électuaire de type majoun », tant les recettes différaient d’un pays à l’autre. Le majoun tunisien, par exemple, se distinguait de ses équivalents turcs ou syriens par la combinaison d’épices et de condiments employés.
D’autres recettes, comme le Dawamesk, faisaient frire les têtes de la fleur dans du beurre ou des huiles parfumées avant d’ajouter musc, cannelle, macis ou clous de girofle, donnant un extrait gras et aromatique. Certaines confiseries plus élaborées, comme les Garawish, mêlaient sirop cuit, opium et épices pour obtenir une pâte dure, parfois comparée au sucre d’orge. Enfin, de nombreuses douceurs populaires — dattes farcies, rahat lokum (loukoum), nougats ou autres spécialités orientales — servaient ponctuellement de support à ces préparations. À travers ces recettes, c’est tout un pan de la gastronomie traditionnelle du monde arabe et méditerranéen qui se révèle : un art du mélange, du parfum et de la sensualité, oscillant entre rituel, plaisir et remède.
L'adoption de la fleur au retour des croisades
En Europe durant le Moyen Âge, des moines et médecins européens, influencés par les traités médicaux arabes et éveillés par les retours de Croisades, ont aussi commencé à expérimenter l’incorporation des graines et des fleurs de chanvre dans des préparations alimentaires aux vertus médicinales. Marqueur de la présence du chanvre dans la culture médiévale, l’inscription sur les arches de la Via Dell'Indipendenza à Bologne de 1220, “Panis Vita, Cannabis Protectio, Vinum Laetitia” se traduit par “Le pain est la vie, le chanvre est la protection, le vin est la joie”.
Retour au Manuel du chanvre
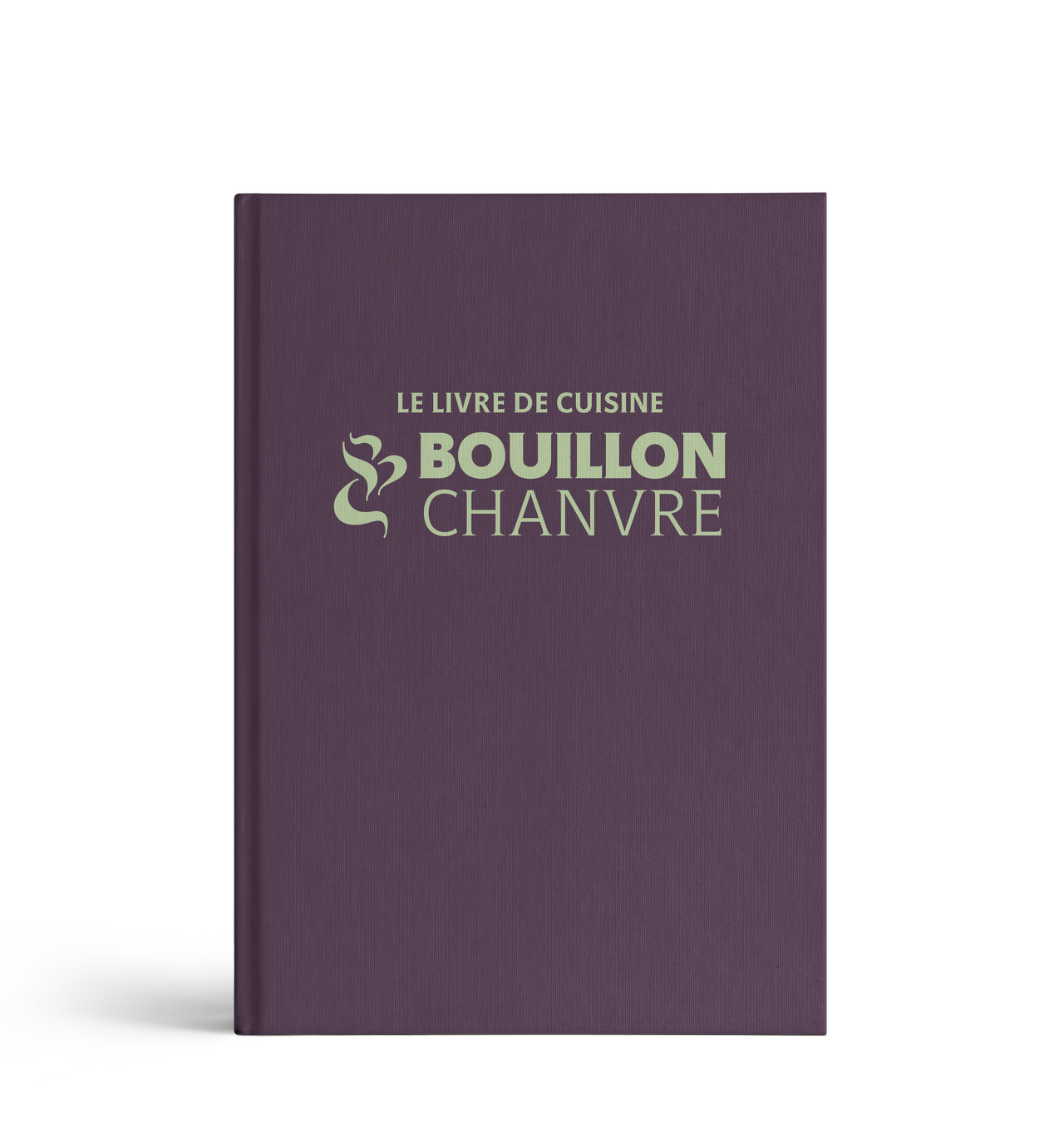
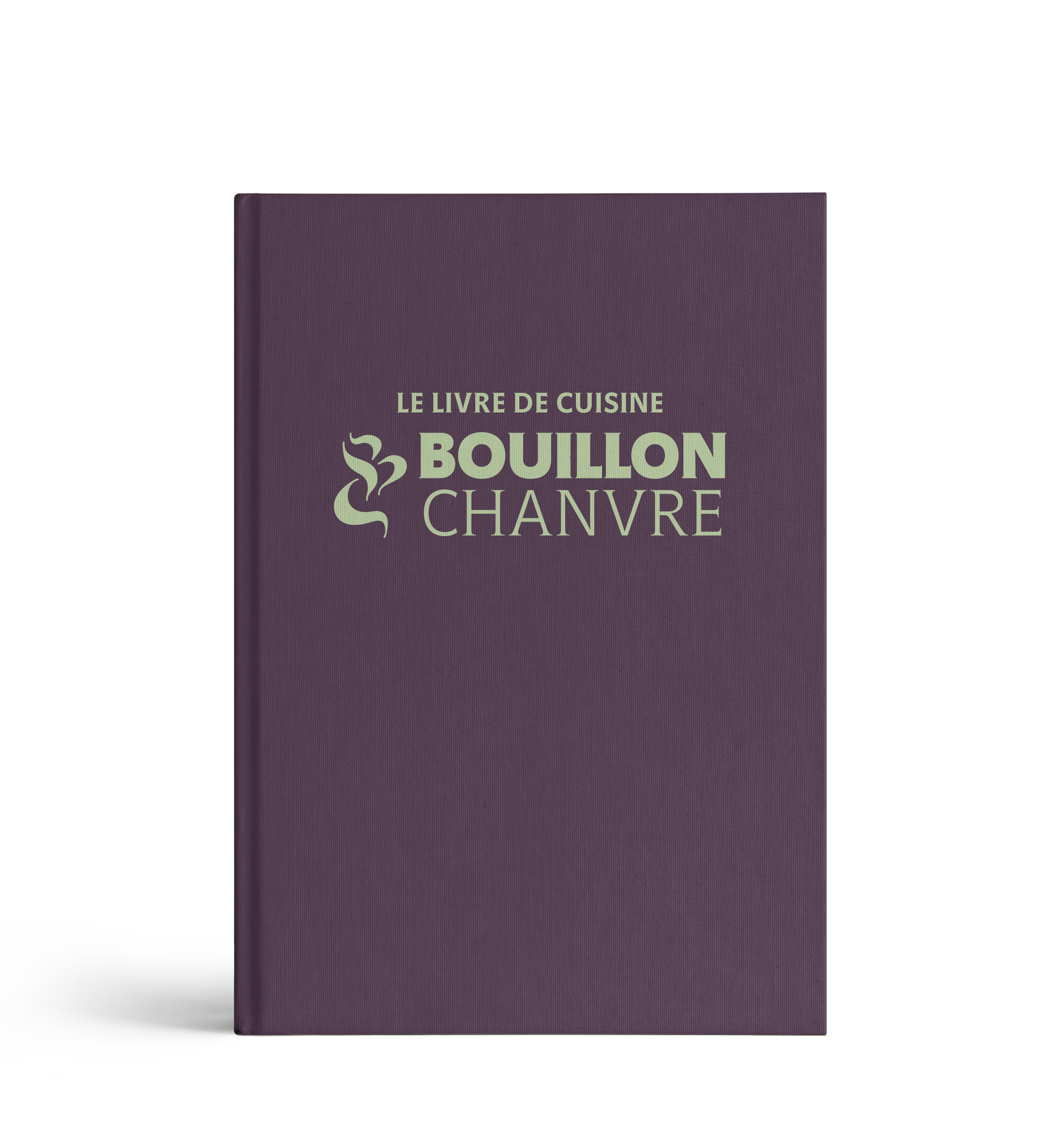
E-book
Téléchargez notre livre de cuisine
10 Chapitres . 60 Pages
110 Recettes . 8 Chefs . Remises produit
Télécharger
Autres articles du manuel

Brochettes de Tempeh, sauce aux agrumes

Brochettes de Tempeh, sauce aux agrumes

Brochettes de Tempeh, sauce aux agrumes

